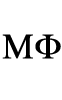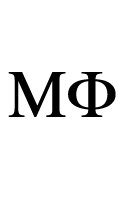Naissance de la biopolitique: Résumé du cours au Collège de France - juin 1979.
— Foucault, Michel. « Naissance de la biopolitique. » In Annuaire du Collège de France, no. 79, année 1978-1979, 367-372.
Le cours de cette année a été finalement consacré, en son entier, à ce qui devait n’en former que l’introduction. Le thème retenu était donc la “biopolitique” : j’entendais par là la manière dont on a essayé, depuis le XVIIIe siècle, de rationaliser les problèmes posés à la pratique gouvernementale par les phénomènes propres à un ensemble de vivants constitués en population: santé, hygiène, natalité, longévité, races… On sait quelle place croissante ces problèmes ont occupée depuis le XIXè siècle, et quels enjeux politiques et économiques ils ont constitués jusqu’à aujourd’hui.
Il m’a semblé qu’on ne pouvait pas dissocier ces problèmes du cadre de rationalité politique à l’intérieur duquel ils sont apparus et ont pris leur acuité. À savoir le “libéralisme”, puisque c’est par rapport à lui qu’ils ont pris l’allure d’un défi. Dans un système soucieux du respect des sujets de droit et de la liberté d’initiative des individus, comment le phénomène “population” avec ses effets et ses problèmes spécifiques peut-il être pris en compte ? Au nom de quoi et selon quelles règles peut-on le gérer ? Le débat qui a eu lieu en Angleterre au milieu du XIXe siècle, concernant la législation sur la santé publique peut servir d’exemple.
Que faut-il entendre par “libéralisme” ? Je me suis appuyé sur les réflexions de Paul Veyne à propos des universaux historiques et de la nécessité de tester une méthode nominaliste en histoire. Et reprenant un certain nombre de choix de méthode déjà faits, j’ai essayé d’analyser le “libéralisme”, non pas comme une théorie ni comme une idéologie, encore moins, bien entendu, comme une manière pour la “société” de “se représenter…”; mais comme une pratique, c’est-à-dire comme une “manière de faire” orientée vers des objectifs et se régulant par une réflexion continue. Le libéralisme est à analyser alors comme principe et méthode de rationalisation de l’exercice du gouvernement —rationalisation qui obéit, et c’est là sa spécificité, à la règle interne de l’économie maximale. Alors que toute rationalisation de l’exercice du gouvernement vise à maximaliser ses effets en en diminuant, le plus possible, le coût (entendu au sens politique non moins qu’économique), la rationalisation libérale part du postulat que le gouvernement (il s’agit là, bien sûr, non pas de l’institution “gouvernement”, mais de l’activité qui consiste à régir la conduite des hommes dans un cadre et avec des instruments étatiques) ne saurait être, à lui-même, sa propre fin. Il n’a pas en soi sa raison d’être, et sa maximalisation, fût-ce aux meilleures conditions possibles, n’a pas à être son principe régulateur. En cela, le libéralisme rompt avec cette “raison d’État” qui, depuis la fin du XVIe siècle, avait cherché dans l’existence et le renforcement de l’État la fin susceptible de justifier une gouvernementalité croissante et d’en régler le développement. La Polizeiwissenschaft développée par les Allemands au XVIIIe siècle, soit parce qu’il leur manquait une grande forme étatique, soit encore et aussi parce que l’étroitesse des découpages territoriaux leur donnait accès à des unités beaucoup plus facilement observables étant donné les instruments techniques et conceptuels de l’époque, se plaçait toujours sous le principe: on ne fait pas assez attention, trop de choses échappent, des domaines trop nombreux manquent de régulation et de règlement, l’ordre et l’administration sont en défaut —bref, on gouverne trop peu. La Polizeiwissenschaft est la forme prise par une technologie gouvernementale dominée par le principe de la raison d’État: et c’est “tout naturellement” en quelque sorte qu’elle prend en compte les problèmes de la population, qui doit être la plus nombreuse et la plus active possible —pour la force de l’État: santé, natalité, hygiène y trouvent donc sans problème une place importante.
Le libéralisme, lui, est traversé par le principe: “On gouverne toujours trop” —ou du moins, il faut toujours soupçonner qu’on gouverne trop. La gouvernementalité ne doit pas s’exercer sans une “critique”, autrement plus radicale qu’une épreuve d’optimisation. Elle ne doit pas s’interroger seulement sur les meilleurs moyens d’atteindre ses effets (ou sur les moins coûteux), mais sur la possibilité et la légitimité même de son projet d’atteindre des effets. Le soupçon qu’on risque toujours de trop gouverner est habité par la question: pourquoi donc faudrait-il gouverner ? De là, le fait que la critique libérale ne se sépare guère d’une problématique, nouvelle à l’époque, de la “société” : c’est au nom de celle-ci qu’on va chercher à savoir pourquoi il est nécessaire qu’il y ait un gouvernement, mais en quoi on peut s’en passer, et sur quoi il est inutile ou nuisible qu’il intervienne. La rationalisation de la pratique gouvernementale, en termes de raison d’État, impliquait sa maximalisation sous condition d’optimum, dans la mesure où l’existence de l’État suppose immédiatement l’exercice du gouvernement. La réflexion libérale ne part pas de l’existence de l’État, trouvant dans le gouvernement le moyen d’attendre cette fin qu’il serait pour lui-même; mais de la société qui se trouve être dans un rapport complexe d’extériorité et d’intériorité vis-à-vis de l’État. C’est elle —à la fois à titre de condition et de fin dernière —qui permet de ne plus poser la question: comment gouverner le plus possible et au moindre coût possible ? Mais, plutôt celle-ci: pourquoi faut-il gouverner ? C’est-à-dire: qu’est-ce qui rend nécessaire qu’il y ait un gouvernement et quelles fins doit-il poursuivre, à l’égard de la société, pour se justifier d’exister. L’idée de société, c’est ce qui permet de développer une technologie de gouvernement à partir du principe qu’étant déjà en lui-même “de trop”, “en excès” —ou du moins qu’il vient s’ajouter comme un supplément auquel on peut et on doit toujours demander s’il est nécessaire et à quoi il est utile.
Plutôt que de faire de la distinction État-société civile un universel historique et politique qui peut permettre d’interroger tous les systèmes concrets, on peut essayer d’y voir une forme de schématisation propre à une technologie particulière de gouvernement.
On ne peut donc pas dire que le libéralisme soit une utopie jamais réalisée —sauf si on prend pour le noyau du libéralisme les projections qu’il a été amené à formuler de ses analyses et de ses critiques. Il n’est pas un rêve qui se heurte à une réalité et manque à s’y inscrire. Il constitue —et c’est là la raison, et de son polymorphisme, et de ses récurrences —un instrument critique de la réalité: d’une gouvernementalité antérieure, dont on essaie de se démarquer; d’une gouvernementalité actuelle qu’on tente de réformer et de rationaliser en la révisant à la baisse; d’une gouvernementalité à laquelle on s’oppose et dont on veut limiter les abus. De sorte qu’on pourra trouver le libéralisme, sous des formes différentes mais simultanées, comme schéma régulateur de la pratique gouvernementale et comme thème d’opposition parfois radicale. La pensée politique anglaise, à la fin du XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe, est fort caractéristique de ces usages multiples du libéralisme. Et plus particulièrement encore les évolutions ou les ambiguïtés de Bentham et des benthamiens.
Dans la critique libérale, il est certain que le marché comme réalité et l’économie politique comme théorie ont joué un rôle important. Mais, comme l’a confirmé le livre important de P. Rosanvallon (Rosanvallon (P.), Le Capitalisme utopique: critique de l’idéologie économique, Paris, Éd. du Seuil, coll, “Sociologie politique”, 1979), le libéralisme n’en est ni la conséquence ni le développement. Le marché a plutôt joué, dans la critique libérale, le rôle d’un “test”, d’un lieu d’expérience privilégiée où on peut repérer les effets de l’excès de gouvernementalité, et même en prendre la mesure: l’analyse des mécanismes de la “disette” ou plus généralement du commerce de grains, au milieu du XVIIIe siècle, avait pour but de montrer à partir de quel point gouverner c’était toujours trop gouverner. Et qu’il s’agisse du Tableau des physiocrates ou de la “main invisible” de Smith, qu’il s’agisse, donc, d’une analyse visant à rendre visible, dans la forme de l’ “évidence”, la formation de la valeur et la circulation des richesses, ou au contraire d’une analyse qui suppose l’invisibilité intrinsèque du lien entre la recherche du profit individuel et l’accroissement de la richesse collective, de toute façon l’économie montre une incompatibilité de principe entre le déroulement optimal du processus économique et une maximalisation des procédures gouvernementales. C’est par là, plus que par le jeu des notions, que les économistes français ou anglais du XVIIIe siècle se sont séparés du mercantilisme et du caméralisme; ils ont fait échapper la réflexion sur la pratique économique à l’hégémonie de la raison d’État et à la saturation par l’intervention gouvernementale. En l’utilisant comme mesure du “trop gouverner”, ils l’ont placée “à la limite” de l’action gouvernementale.
Le libéralisme ne dérive pas plus, sans doute, d’une réflexion juridique que d’une analyse économique. Ce n’est pas l’idée d’une société politique fondée sur un lien contractuel qui lui a donné naissance. Mais, dans la recherche d’une technologie libérale de gouvernement, il est apparu que la régulation par la forme juridique constituait un instrument autrement efficace que la sagesse ou la modération des gouvernants. (Les physiocrates, eux, avaient plutôt tendance, par méfiance du droit et de l’institution juridique, à chercher cette régulation dans la reconnaissance, par un despote au pouvoir institutionnellement illimité, des lois “naturelles” de l’économie s’imposant à lui comme vérité évidente.) Cette régulation, c’est dans la “loi” que le libéralisme l’a cherchée, non point par un juridisme qui lui serait naturel, mais parce que la loi définit des formes d’interventions générales exclusives de mesures particulières, individuelles, exceptionnelles, et parce que la participation des gouvernés à l’élaboration de la loi, dans un système parlementaire, constitue le système le plus efficace d’économie gouvernementale. L’”État de droit”, le Rechtsstaat, le Rule of Law, l’organisation d’un système parlementaire “réellement représentatif” ont donc, pendant tout le début du XIXe siècle, partie liée avec le libéralisme, mais tout comme l’économie politique utilisée d’abord comme critère de la gouvernementalité excessive n’était ni par nature ni par vertu libérale, et qu’elle a même vite induit des attitudes antilibérales (que ce soit dans la Nationaloekonomie du XIXe et dans les économies planificatrices du XXe), de même la démocratie et l’État de droit n’ont pas été forcément libéraux, ni le libéralisme forcément démocratique ou attaché aux formes du droit.
Plutôt donc qu’une doctrine plus ou moins cohérente, plutôt qu’une politique poursuivant un certain nombre de buts plus ou moins définis, je serais tenté de voir, dans le libéralisme, une forme de réflexion critique sur la pratique gouvernementale; cette critique peut venir de l’intérieur ou de l’extérieur; elle peut s’appuyer sur telle théorie économique, ou se référer à tel système juridique sans lien nécessaire et univoque. La question du libéralisme, entendue comme question du “trop gouverner”, a été l’une des dimensions constantes de ce phénomène récent en Europe et apparu, semble-t-il, d’abord en Angleterre: à savoir la “vie politique”; elle en est même l’un des éléments constituants, si tant est que la vie politique existe lorsque la pratique gouvernementale est limitée dans son excès possible par le fait qu’elle est l’objet de débat public quant à son “bien ou mal”, quant à son “trop ou trop peu”.
Bien sûr, il ne s’agit pas là d’une “interprétation” du libéralisme qui se voudrait exhaustive, mais d’un plan d’analyse possible celui de la “raison gouvernementale”, c’est-à-dire de ces types de rationalité qui sont mis en oeuvre dans les procédés par lesquels on dirige, à travers une administration étatique, la conduite des hommes. Une telle analyse, j’ai essayé de la mener sur deux exemples contemporains: le libéralisme allemand des années 19481962, et le libéralisme américain de l’école de Chicago. Dans les deux cas, le libéralisme s’est présenté, dans un contexte très défini, comme une critique de l’irrationalité propre à l’excès de gouvernement, et comme un retour à une technologie de gouvernement frugal, comme aurait dit Franklin.
Cet excès, c’était en Allemagne le régime de guerre, le nazisme, mais, au-delà, un type d’économie dirigiste et planifiée issue de la période 1914-1918 et de la mobilisation générale des ressources et des hommes; c’était aussi le “socialisme d’État”. En fait, le libéralisme allemand du second après-guerre a été défini, programmé et même, pour une certaine part, mis en application par des hommes qui, à partir des années 1928-1930, avaient appartenu à l’école de Fribourg (ou du moins avaient été inspirés par elle) et qui s’étaient exprimés plus tard dans la revue Ordo. Au point de croisement de la philosophie néokantienne, de la phénoménologie de Husserl et de la sociologie de Max Weber, proches sur certains points des économistes viennois, soucieux de la corrélation qui se manifeste dans l’histoire entre processus économiques et structures juridiques, des hommes comme Eucken, W. Roepke, Franz Böhm, von Rustow avaient mené leurs critiques sur trois fronts politiques différents: socialisme soviétique, national-socialisme, politiques interventionnistes inspirées par Keynes; mais ils s’adressaient à ce qu’ils considéraient comme un adversaire unique: un type de gouvernement économique systématiquement ignorant des mécanismes de marché seuls capables d’assurer la régulation formatrice des prix. L’ordolibéralisme, travaillant sur les thèmes fondamentaux de la technologie libérale de gouvernement, a essayé de définir ce que pourrait être une économie de marché, organisée (mais non planifiée, ni dirigée) à l’intérieur d’un cadre institutionnel et juridique, qui, d’une part, offrirait les garanties et les limitations de la loi, et, d’autre part, assurerait que la liberté des processus économiques ne produise pas de distorsion sociale. C’est à l’étude de cet ordolibéralisme, qui avait inspiré le choix économique de la politique générale de la R.F.A., à l’époque d’Adenauer et de Ludwig Ehrard, qu’a été consacrée la première partie du cours.
La seconde l’a été à quelques aspects de ce qu’on appelle le néolibéralisme américain: celui qu’on place en général sous le signe de l’école de Chicago et qui s’est développé lui aussi en réaction à ce “trop de gouvernement” que représentaient à ses yeux, depuis Simons, la politique du New Deal, la planification de guerre et les grands programmes économiques et sociaux soutenus la plupart du temps dans l’après-guerre par les administrations démocrates. Comme chez les ordolibéraux allemands, la critique faite au nom du libéralisme économique s’autorise du danger que représenterait l’inévitable séquence: interventionnisme économique, inflation des appareils gouvernementaux, suradministration, bureaucratie, rigidification de tous les mécanismes de pouvoir, en même temps que se produiraient de nouvelles distorsions économiques, inductrices de nouvelles interventions. Mais, ce qui a retenu l’attention dans ce néolibéralisme américain, c’est un mouvement tout à fait opposé à ce qu’on trouve dans l’économie sociale de marché en Allemagne: alors que celle-ci considère que la régulation des prix par le marché —seul fondement d’une économie rationnelle —est de soi si fragile qu’elle doit être soutenue, aménagée, “ordonnée” par une politique interne et vigilante d’interventions sociales (impliquant des aides aux chômeurs, des couvertures des besoins de santé, une politique du logement, etc.), ce néolibéralisme américain cherche plutôt à étendre la rationalité du marché, les schèmes d’analyse qu’elle propose et les critères de décision qu’elle suggère à des domaines non exclusivement ou non premièrement économiques. Ainsi, la famille et la natalité; ainsi, la délinquance et la politique pénale.
Ce qui devrait donc être étudié maintenant, c’est la manière dont les problèmes spécifiques de la vie et de la population ont été posés à l’intérieur d’une technologie de gouvernement qui, sans avoir, loin de là, toujours été libérale n’a pas cessé d’être hantée depuis la fin du XVIIIe siècle par la question du libéralisme.
Le séminaire a été consacré cette année à la crise de la pensée juridique dans les dernières années du XIXe siècle. Des exposés ont été faits par François Ewald (sur le droit civil), Catherine Mevel (sur le droit public et administratif), Éliane Allo (sur le droit à la vie dans la législation sur les enfants), Nathalie Coppinger et Pasquale Pacquino (sur le droit pénal), Alexandre Fontana (sur les mesures de sécurité), François Delaporte et Anne-Marie Moulin (sur la police et la politique de santé).